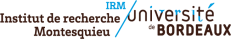Sous la direction du Professeur Yann Raison-Du-Cleuziou
Membres du jury
- Jean-Michel Eymeri-Douzans, professeur des universités, Sciences Po Toulouse
- Xabier Itçaina, directeur de recherche CNRS, Science Po Bordeaux
- Camille Mazé-Lambrechts, directrice de recherche CNRS, Sciences Po Paris
- Sylvie Ollitrault, directrice de recherche CNRS, Ecole des hautes études en santé publique
- Yann Raison-du Cleuziou, professeur des universités, université de Bordeaux
- Bruno Villalba, professeur des universités, AgroParisTech
Résume de la thèse
Cette thèse entend démontrer que, pour analyser les trajectoires de conversion écologique, la sociologie des religions est heuristique, en complément des approches classiques de science politique. Dramatisée par la catégorie de l’anthropocène, qui place l’humanité devant la perspective de sa fin, l’urgence écologique impose une conversion, dont le salut individuel et collectif est l’enjeu. La question écologique reconfigure le politique, en restaurant des dimensions eschatologiques, voire apocalyptiques qui avaient disparu avec l’avènement de la démocratie libérale. L’analyse des trajectoires de conversion des virtuoses de l’écologie permet d’étudier cette reconfiguration. À cette fin, il est heuristique d’accorder une place centrale aux catégories d’analyse de la sociologie des religions, souvent marginalisées dans le cadre de la sociologie des mobilisations. La thèse est que, pour penser la conversion écologique, la référence à la religion ne doit pas rester un simple registre métaphorique, mais doit être honorée comme une proposition épistémologique forte. S’appuyant sur la sociologie des religions wébérienne, ce travail entreprend de dévoiler les dimensions post-séculières des problèmes pratiques et éthiques que soulève la conversion. Empiriquement, il s’appuie sur des entretiens non directifs avec des « virtuoses » de l’écologie (élus, associatifs, hauts fonctionnaires, militants de groupes de désobéissance civile). Leur univers est structuré par des dynamiques et des conflits qui furent longtemps ceux des Églises. La conversion procède ainsi d’une mise en urgence de l’existence, qui doit sans cesse être réactivée contre l’érosion du quotidien. Son intensité dépend de la profondeur de la prise de conscience du « mal » anthropique dont la libération est un combat aux horizons personnels et collectifs. L’écologie apparaît comme un régime de vérité à partir duquel s’organisent une sotériologie et des voies ascétiques. La transformation du rapport à soi ne peut aboutir que dans la transformation de la société par un prosélytisme, dont la modalité reste toujours problématique dans la mesure où l’image sociale du converti peut être compromise. Enfin, l’univers des convertis est mis en tension entre des nécessités élitistes et des aspirations démocratiques, qui rejouent la rivalité entre secte et Église décrite par Troeltsch. L’apport analytique de la sociologie des religions à la science politique de l’écologie n’est pas de réduire l’écologie à la religion mais de souligner les dimensions post-séculières qui s’engagent dans la praxis de la conversion et que l’analogie permet seule de repérer. Par ses dimensions postséculières, la conversion écologique de ces virtuoses contribue à un paradoxal réenchantement d’un monde menacé par la fin.